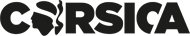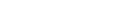Rechercher...
La destination Corse
Le métier de berger en Corse : gardiens d’un patrimoine vivant Nouveau
 Lionel Pinzuti, berger à Bastelica
Lionel Pinzuti, berger à Bastelica
¹ https://bluebees.fr/fr/project/180-berger
Un parcours atypique vers le pastoralisme
Tous les bergers corses ne naissent pas avec cette vocation familiale. « Je ne suis pas d’une famille de bergers », explique Lionel Pinzuti. Son parcours professionnel a d’abord emprunté d’autres voies. Il a été maçon, serveur en restaurant, employé à la station de ski du Val d’Ese, puis barman la nuit dans un piano-bar.
La reconversion intervient à 33 ans : « J’avais fait mon lycée agricole pour avoir mon diplôme et un jour, j’ai dit bon allez, maintenant, j’arrête et je m’installe. » Cette décision marque un tournant radical qui nécessite de créer une exploitation de toutes pièces : « Il a fallu que je fasse tous les bâtiments, les clôtures. J’ai tout créé de A à Z. »
L’élevage extensif dans le maquis corse
Le système d’élevage insulaire exploite les ressources naturelles sur de vastes étendues. Lionel gère son troupeau composé d’une trentaine de jeunes et d’une quinzaine de boucs en plus de ses chèvres adultes. « En déclaration, j’ai 300 hectares de maquis, mais les chèvres, elles parcourent plus parce qu’il n’y a pas de clôture. »
Le rythme quotidien suit une organisation ancestrale : « Les chèvres partent dans la montagne, pâturent toute la journée et rentrent le soir. » Cette liberté de pâturage caractérise l’élevage extensif, où les animaux valorisent naturellement la biodiversité du maquis.
Les chèvres corses, race reconnue en 2003, pèsent de 35 à 45 kg pour les femelles. Leur robe à longs poils les protège des épineux, leurs sabots puissants leur permettent d’évoluer sur les terrains les plus accidentés. Cette rusticité exceptionnelle s’adapte parfaitement aux 117 sommets corses de plus de 2 000 mètres d’altitude.
L’art de la transformation fromagère
 L’affinage des fromages, une étape importante dans sa fabrication ©ADOBESTOCK
L’affinage des fromages, une étape importante dans sa fabrication ©ADOBESTOCK
La fabrication du fromage constitue le cœur économique de l’activité. Lionel a développé sa propre technique en s’inspirant des anciens : « Je demandais un peu à tous les vieux du village comment ils faisaient leurs fromages et je me suis fait une idée. » Il produit ainsi le Bastelicaccia, un fromage à caillage lactique sur 24 heures.
Face à la routine quotidienne, l’innovation devient nécessaire : « Un jour, je me suis aperçu que ma journée, c’était la traite et le fromage. Mais c’était presque devenu une routine et je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose en plus. » Cette réflexion l’amène vers les fromages aromatisés. Il commence par le thym, puis étend la gamme avec la menthe, la confiture, les figues confites, et même le caramel au beurre salé.
Les repas à la ferme : cultiver l’authenticité
 La bergerie se transforme en table d'hôte, pour un dîner aux chandelles et à la belle étoile ©ADOBESTOCK
La bergerie se transforme en table d'hôte, pour un dîner aux chandelles et à la belle étoile ©ADOBESTOCK
L’agrotourisme complète l’activité fromagère. « Ce que je fais à la bergerie, ce n’est pas une soirée dégustation, c’est un repas à la ferme », précise Lionel. La formule privilégie l’intimité : « C’est sur réservation avec 20 personnes maximum. Je veux que ça reste convivial. »
L’observation des comportements a façonné le concept : « Je me suis aperçu qu’en faisant entrée-plat-dessert, pendant que les gens attendaient, ils buvaient un petit coup. C’est là que se passait la convivialité. » Cette analyse l’a conduit à supprimer l’entrée au profit d’un apéritif prolongé avec des préparations maison.
L’ambiance nocturne crée une expérience unique : « La table est entièrement éclairée à la bougie. Comme il n’y a pas de pollution lumineuse, les gens voient tout le ciel étoilé. »
Un secteur en mutation face aux défis contemporains
 Troupeau de chèvres corses ©ADOBESTOCK
Troupeau de chèvres corses ©ADOBESTOCK
La profession traverse une période difficile. En vingt ans, la Corse a perdu 20 000 brebis et est passée de 1 000 éleveurs ovins en 1985² à 790 aujourd’hui³. Les épidémies de fièvre catarrhale ont causé la mort de 43 000 brebis depuis 2000 ⁴.
Aujourd’hui, les bergers fromagers de l’île gèrent 72 000 brebis et 30 000 chèvres mères⁵. La production annuelle atteint 11 millions de litres de lait⁶. Le secteur offre 200 emplois avec 106 projets de recrutement prévus, mais 94 % concernent des postes saisonniers⁷.
Des actions concrètes soutiennent néanmoins la filière. L’AOP Brocciu a été reconnue en 1983, la race ovine corse en 1987⁸. Les progrès génétiques ont permis d’augmenter la production laitière de 40 %⁹. Les éleveurs ont redistribué 8 000 béliers et 15 000 agnelles de qualité dans le cheptel insulaire¹⁰.
² ⁴ ⁹ ¹⁰ https://bluebees.fr/fr/project/180-berger
³ ⁵ ⁶ ⁸ https://www.ilocc-corse.com/la-filiere-lait
⁷ https://orientazione.isula.corsica/metier/berger-bergere/
 Une bergerie traditionnelle Corse en pierre sèche ©adobestock
Une bergerie traditionnelle Corse en pierre sèche ©adobestock
| Bon à savoir : L'héritage des bergeries de pierre sèche Les bergeries traditionnelles (u stazzu) témoignent du génie architectural pastoral. Construites sans mortier, elles comprennent la cabane du berger (a capanna) avec sa voûte en encorbellement, l'espace de travail (tinellaghju) et les caves d'affinage (i casgili). Ces dernières, construites moins hautes pour conserver la fraîcheur, possèdent une entrée réduite par laquelle on se glissait à plat ventre. Ces constructions représentent un patrimoine architectural menacé de disparition. |
Perspectives d'avenir et diversification
 La bergerie nichée sur les hauteurs des gorges du Prunelli ©adobestock
La bergerie nichée sur les hauteurs des gorges du Prunelli ©adobestock
L'adaptation aux nouvelles demandes guide les projets futurs. Lionel envisage l'hébergement insolite : « Il y a des gens qui me disent que c'est dommage qu'on ne puisse pas dormir. Je vais peut-être faire des petites cabanes en bois sommaires, juste avec un lit dedans”. »
La reconnaissance de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre 2023 valorise ces pratiques¹¹. Cette distinction, obtenue par dix pays européens, célèbre les impacts positifs du pastoralisme sur l'environnement. Il prévient les incendies (130 hectares brûlés en Haute-Corse lors de la saison 2024¹²) et maintient la biodiversité de l’île.
 Vue sur le lac de Todda (Tolla) depuis les Gorges du Prunelli ©adobestock
Vue sur le lac de Todda (Tolla) depuis les Gorges du Prunelli ©adobestock
« Vous êtes au milieu de nulle part, vous avez des montagnes partout, il n'y a pas de maisons autour ». Dans ces territoires isolés, les bergers font vivre une économie locale authentique. Leur présence quotidienne freine l'abandon rural et entretient des écosystèmes fragiles que seul le pâturage peut gérer.